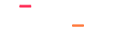Visions célestes
- Grand concert symphonique
- Lieu Halle aux Grains
-
Public
- Tout Public
- Tarif De 18 à 65€
La puissance émotionnelle d'une symphonie de Bruckner
Intime et gigantesque, bouleversante et spectaculaire, la Symphonie n° 8 est l’œuvre de tous les paroxysmes ! Pour qui ne connaît pas l’univers de Bruckner, elle constitue une superbe initiation. Qui aime le compositeur autrichien sait à quel point entendre cette œuvre demeure une expérience… hors normes. Tugan Sokhiev dirige une pièce qu’il adore, et qui est un somptueux défi orchestral.
Tugan Sokhiev / Direction
Programme :
Bruckner
Symphonie n°8 en ut mineur, A. 117