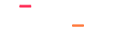Crépuscule viennois
Modifié le :

Mahler, une philosophie américaine
Entretien avec Joseph Swensen
Peu de chefs connaissent l’Orchestre national du Capitole aussi bien que Joseph Swensen. Entre le musicien américain et les interprètes toulousains s’est nouée, il y a de cela tout juste vingt ans, une véritable histoire d’amitié musicale. À la veille de son concert consacré à la mythique Symphonie n° 9 de Gustav Mahler, Joseph Swensen revient sur cette relation hors du commun.
Vous êtes l’un des compagnons de route d’élection de l’Orchestre national du Capitole, et vous avez vu, comme peu d’autres, évoluer l’effectif avec lequel vous entretenez une relation très forte. Quel regard portez-vous sur cet orchestre ?
Cela fait plus de vingt ans que nous travaillons ensemble, et il me semble que cela fait plus longtemps encore ! J’ai l’impression d’avoir connu ces musiciens toute ma vie, et j’ai eu ce sentiment dès notre première rencontre, en dirigeant la Symphonie n° 3 de Mahler. C’était magique. Parfois, les relations avec les orchestres sont les mêmes que celles que vous pouvez nouer individuellement : vous rencontrez quelqu’un que vous avez le sentiment d’avoir toujours connu, et dès que vous le revoyez, vous avez le sentiment de le redécouvrir. C’est exactement ce qui s’est passé avec le Capitole : nous nous retrouvons une ou deux fois par saison, et la surprise demeure. Comme des amis proches, nous avons la même curiosité pour l’autre. Nous avons bien de la chance !
Aujourd’hui, vous revenez à Toulouse avec Gustav Mahler, un compositeur qui occupe une place singulière dans votre relation à l’Orchestre. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Mahler, plus que tous les autres compositeurs, possède une philosophie à laquelle j’adhère totalement. Bien entendu, j’aime sa musique, mais il me semble que la philosophie avec laquelle il compose va bien au-delà de son œuvre : Mahler écrit pour des individus dans l’orchestre. Il met en œuvre l’idée d’un orchestre qui n’est pas seulement l’instrument de travail d’un chef. Un orchestre est constitué de cent musiciens passionnés. Le rôle du chef est simplement de les aider à travailler ensemble, sans écraser leur personnalité ou exiger d’eux qu’ils se conforment à sa vision. Tout Mahler réside dans cette idée.
Finalement, il s’agit quasiment d’une vision du monde…
Oui, je le crois. Il me semble que la plupart des compositeurs qui écrivent pour l’orchestre ne partagent pas une telle ambition humaine. Ils composent pour l’effectif comme s’il s’agissait d’un seul et gigantesque instrument, d’une armée. Chacun doit faire ce qui est écrit et personne ne pense ou ressent par soi même. En cela, Mahler amène quelque chose de révolutionnaire grâce à la relation qu’il déploie entre le chef et les instrumentistes. Finalement, réfléchir à ces enjeux existentiels par la musique me semble bien plus convaincant qu’à travers les mots, car ceux-ci sont limitent l’imagination. La musique est infinie.
Pendant toutes ces années, votre vision de Mahler au Capitole a-t-elle changé ?

Quelle question difficile ! Seul Thierry d’Argoubet qui a vu ce travail évoluer d’année en année pourrait y répondre. J’ai changé, je change chaque jour. Nous travaillons la même musique, celle de Mahler, et elle est si différente, dans mon esprit, que lorsque nous avons démarré il y a plus de vingt ans. L’Orchestre lui-même a beaucoup évolué, à la fois en tant que groupe et comme ensemble d’individus : une nouvelle génération de musiciens est arrivée, avec une nouvelle vision, de nouveaux rêves, ce qui est particulièrement exaltant pour moi. J’ai envie de les connaître, de savoir comment ils vont s’emparer de l’œuvre. N’est-ce pas la plus belle des choses ?
Comment percevez-vous la Symphonie n° 9 ? Comment pourriez-vous présenter ce testament du musicien viennois à un public qui ne l’aurait jamais entendu ?
Tant de choses ont été écrites sur cette pièce. Nous savons que Mahler était hanté par le chiffre neuf, par l’ombre de Beethoven, qu’il était très malade et qu’il pressentait que ce serait sa dernière œuvre. D’autant que, très superstitieux, il craignait que cela ne lui porte malheur. Je crois que ce contexte est très sensible dans la pièce : il ne s’agit pas seulement d’une magnifique symphonie, la présence de la mort y est palpable. Mahler utilise sa propre expérience pour faire de cette œuvre un monde en soi. En cela, il n’est pas seulement en quête de beauté. La Symphonie n° 9 n’est pas seulement belle. Évidemment, elle l’est, comme l’est le monde entier, comme le sont tant de nos expériences dans la vie. Mais elle embrasse aussi la souffrance, l’angoisse, la peur de la mort.
La beauté et l’horreur y cohabitent. Nous voudrions que l’art soit bon, au sens chrétien du terme. Mais l’art est bien plus que cela, il est tout. Voilà ce qu’est cette dernière symphonie de Mahler, bien davantage que toutes les précédentes.
Finalement, il y aurait quelque chose de l’aurore et du crépuscule dans cette œuvre…
Oui, mais n’en est-il pas ainsi dans l’existence ? Cette dimension crépusculaire passe aussi par son lien au passé ! Quand Mahler compose ses symphonies, le genre est quasiment passéiste : Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms l’ont investi. Mais à la veille du XXe siècle, l’opéra, le théâtre dominent. Même Strauss privilégie des poèmes symphoniques à dimension narrative. De ce point de vue, Mahler demeure très inscrit dans le passé. Mais sa perspective philosophique ouvre grand les portes de l’avenir. Et enfin, il y a la « part américaine » de l’oeuvre. Selon moi, la singularité de la culture des États-Unis est de parvenir à accueillir toutes les cultures du monde sans les gommer. Mes grands-parents sont arrivés du Japon et de Norvège. Mes parents se sont rencontrés à New- York. Il s’agit là d’une histoire américaine typique. Il y a bien des choses que je n’aime pas dans la culture américaine. Mais l’un des aspects qui continue à me fasciner – et où j’entends bien des résonances avec la philosophie de Mahler – est sa capacité à accueillir les individualités dans leur singularité profonde. C’est là pour moi la force de l’Amérique. N’oublions pas que Mahler vécut à New-York pour diriger, qu’il y travailla à la Symphonie n° 9. Je pense qu’il y réalisa combien sa manière d’envisager la musique avait de points communs avec la pensée de Thomas Jefferson !
Propos recueillis par Charlotte Ginot-Slacik